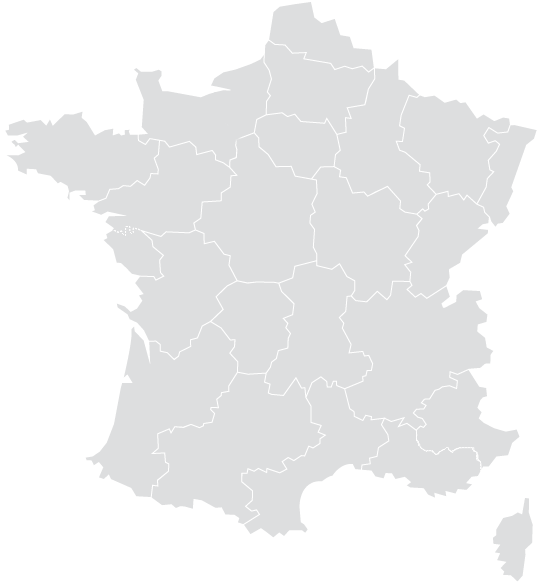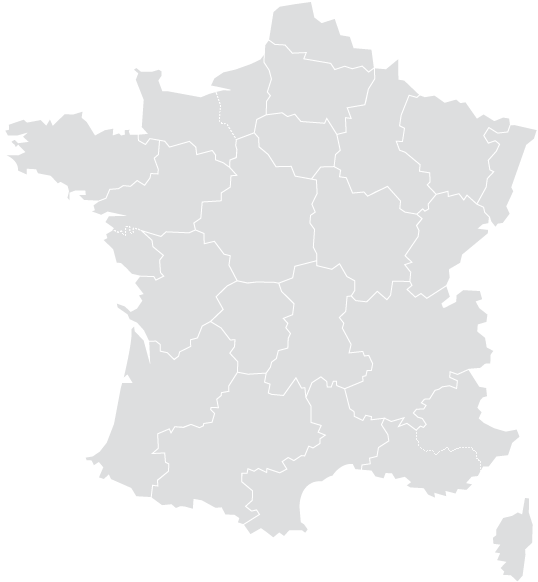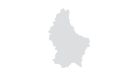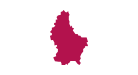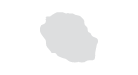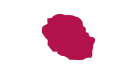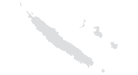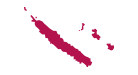Données Partagées a interrogé Jean-Marc Jaumouillé[1] sur l’encadrement juridique de la sous-traitance entre experts-comptables.
DP : Vous semblez ne pas apprécier l’emploi du terme « sous-traitance » pour qualifier les travaux réalisés par un expert-comptable pour le compte d’un autre expert-comptable ?
JMJ : L’emploi de ce terme ne me gêne pas dès lors qu’il recouvre la même réalité économique et juridique pour tous ; ce qui ne se limite pas aux parties au contrat, mais s’étend aussi aux bénéficiaires des travaux, aux administrations (comme les URSSAF ou l’inspection du travail) et enfin aux tribunaux. Est-ce que, par exemple, l’expert-comptable « titulaire » de la mission entend faire agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le client ? Dans la pratique de l’expertise comptable, ce n’est pratiquement jamais appliqué. Or, c’est un élément essentiel de la mise en place de la sous-traitance.
Je comprends que dans une acception historique au sein de notre profession, l’on regroupe sous ce vocable tous les travaux confiés par un expert-comptable à un autre, quelles qu’en soient la nature et les modalités opérationnelles. C’est plus simple. Néanmoins la prudence s’impose au moment de la contractualisation, car toutes les situations ne relèvent de la sous-traitance au sens juridique. La sous-traitance n’est pas seulement un concept économique, c’est aussi un concept juridique encadré par une loi[2] et diverses autres dispositions législatives, réglementaires et jurisprudentielles.
DP : Comment peut-on distinguer la sous-traitance d’un autre type de contrat ?
JMJ : Seul l’examen des circonstances permet de qualifier la nature juridique de la coopération. Si la mission confiée vise quelques clients dénommés et que les travaux sont parfaitement dissociables des autres interventions du cabinet donneur d’ordre, nous pouvons être en présence d’un contrat de sous-traitance. Rappelons que la signature d’un tel contrat oblige à faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, afin d’ouvrir au sous-traitant un droit à paiement direct par le maître d’ouvrage en cas de défaut de paiement de l’entrepreneur principal. Ces exigences semblent plus délicates à mettre en œuvre si les travaux ne sont pas dissociables ou que la mission confiée s’assimile plus à un renfort humain pendant une période donnée, sans qu’une liste de clients ne soit préalablement arrêtée. Dans ces cas, nous sommes plus en présence d’un contrat de collaboration libérale ou d’un contrat de prestation de services.
DP : Dans le doute, existe-t-il un contrat meilleur que les autres ?
JMJ : Dans l’absolu, aucun type de contrat n’est meilleur qu’un autre. Le contrat choisi doit être adapté aux circonstances, refléter la volonté des parties tout en demeurant équilibré. Mais vous pouvez disposer d’un contrat de qualité, il n’empêchera pas les litiges, au-delà même de la survenance de certains événements, si les parties ou l’une d’elles n’acceptent pas d’en respecter la lettre et l’esprit. Heureusement, notre profession semble plutôt épargnée par ces comportements déloyaux. Les instances disciplinaires sont très rarement saisies de tels litiges.
DP : Est-il alors bien nécessaire de toujours faire un contrat écrit ?
JMJ : Oui, ne serait-ce que pour satisfaire aux obligations du code de déontologie. L’article 151 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 dispose que les experts-comptables « passent avec leur client […] un contrat écrit définissant leur mission et précisant les droits et obligations de chacune des parties. » L’expert-comptable qui confie des travaux à un autre expert-comptable est bien le client du second.
Le principal intérêt d’un contrat est de permettre aux parties, avant que ne débute la relation contractuelle, d’évoquer plusieurs points sensibles et de trouver un accord sur les droits et les devoirs de chacune. Il convient d’y laisser une place réduite à la subjectivité dans l’analyse future des faits, car sinon les perceptions de la réalité exacerbent les sentiments d’injustice de part et d’autre et rendent plus incertaines une entente durable entre les parties.
Bien que l’on ait pu attacher un grand soin à la rédaction du contrat, le juge ne s’en tiendra pas à la seule volonté des parties, ni à aux termes et à la dénomination de la convention de coopération. Il s’intéressera aux conditions concrètes dans lesquelles est exécutée la prestation pour déterminer la nature du contrat et les règles juridiques qui lui sont applicables.
DP : Quels sont les points d’attention ?
JMJ : Les plus délicats sont sans nul doute la nature et le contenu des prestations confiées à l’expert-comptable, car ils recèlent en eux tous les germes d’une possible requalification du contrat. Le preneur ou l’URSSAF peuvent être tentés de rechercher sa requalification en contrat de travail, le premier pour obtenir des indemnités de résiliation non prévues au contrat, la seconde pour appliquer les cotisations dues sur les salaires. Si le preneur fait intervenir ses propres salariés, la coopération peut aussi tomber sous le coup du prêt de main d’œuvre illicite ou du marchandage.
Les modalités de détermination de la rémunération présentent également des risques. D’abord, pour que chacune des parties la perçoive comme juste, notamment lorsque les conditions de réalisation diffèrent de celles qui avaient été prévues, engendrant des dépassements de temps. Ensuite, un paiement calculé sur une base horaire est déconseillé, car elle présume un manque d’indépendance du preneur vis-à-vis du donneur d’ordre.
Il est également essentiel de déterminer la durée du contrat ainsi que la gestion des absences si la mission confiée occupe une grande partie de l’emploi du temps du preneur.
DP : Faut-il en informer obligatoirement le client ?
JMJ : Quel que soit le contrat, il est impératif que le donneur d’ordre obtienne l’accord exprès du client sur le principe de l’intervention d’un tiers au cabinet, pour des raisons liées au secret professionnel et pour que la lettre de mission originelle demeure opposable au client.
DP : Est-ce qu’un contrat de coopération peut prévoir une clause d’exclusivité empêchant le preneur de constituer son propre portefeuille ou de collaborer avec d’autres cabinets ?
JMJ : Si le donneur d’ordre imposait une telle clause, il serait bien imprudent. Cette seule clause suffirait à démontrer le lien de dépendance entre les parties au contrat et favoriserait aussi sa requalification en contrat de travail, avec toutes les conséquences dommageables que l’on connaît.
Ce type de clause est formellement interdit en cas de collaboration libérale.
DP : Est-ce que le preneur peut refuser certaines missions confiées par le donneur d’ordre ?
JMJ : Les parties sont tenues par le contrat qui les lie. Si une liste de clients a été arrêtée, le preneur n’est pas obligé de traiter des dossiers hors liste. Il n’est pas impossible que cette attitude nuise à la relation entre les deux confrères. En revanche, le preneur doit refuser certains travaux si leur accomplissement compromet son indépendance, son intégrité et son objectivité ou le place en situation de conflit d’intérêt. Il est préférable de prévoir de telles clauses au contrat afin d’éviter toute incompréhension future.
DP : Un contrat d’assurance spécifique est-il nécessaire ?
JMJ : Les deux parties au contrat doivent être assurées séparément afin de respecter les exigences de l’article 17 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 régissant notre profession, d’autant plus que chaque professionnel assume la responsabilité personnelle de ses travaux en vertu de l’article 12 de cette même ordonnance. C’est d’autant plus nécessaire que cette disposition induit une possible mise en cause de la responsabilité du preneur par le client, bien qu’il n’existe aucun lien contractuel entre eux, et que le second ait, ou non, agréé le premier. Cette mise en cause repose sur les fondements de la responsabilité quasi-délictuelle.
Le preneur interrogera malgré tout son assureur par écrit pour savoir si son contrat couvre les travaux effectués au bénéfice d’un autre expert-comptable. Le contrat groupe de la profession le prévoit, mais pas nécessairement les autres.
Quant à la garantie minimum, la limite imposée par l’article 138 du décret précité, à savoir 500 000 euros par sinistre, est à mon avis insuffisante pour protéger convenablement un professionnel aguerri. J’en suis encore plus persuadé pour un jeune professionnel qui manque par essence d’expérience professionnelle. Il serait bien avisé de revaloriser son plafond de garantie, d’autant plus que le surcoût n’est pas proportionnel à l’augmentation de la garantie. Dans un contrat de coopération avec un autre cabinet, le preneur peut en plus être conduit à réaliser des travaux débouchant sur des risques potentiels dépassant ce plafond. C’est pourquoi il a intérêt à examiner avec attention les travaux confiés, et le cas échéant à opter pour une revalorisation de son contrat pour les seuls travaux présentant un risque élevé. La couverture du risque est personnalisable par client (y compris dans le cadre d’une coopération où l’on n’est pas titulaire de la mission). Là aussi, le coût marginal est faible.
DP : Le preneur peut-il conserver des documents relatifs à sa ou ses missions ?
JMJ : Dans la mesure où sa responsabilité est susceptible d’être engagée tant que la prescription n’est pas éteinte, il devrait conserver une preuve des travaux qu’il a réalisés. Si le donneur d’ordre s’y oppose, les modalités d’accès à ces données devront être prévues au contrat de coopération.
DP : Si après le terme de la mission, le preneur est sollicité par un client du donneur d’ordre qui souhaite entamer une collaboration avec lui, peut-il l’accepter ?
JMJ : En règle générale, une clause l’interdisant figure au contrat. Mais elle peut aussi être mal rédigée, laissant place à des exégèses non partagées et à de possibles litiges.
Certes le client est libre de choisir son expert-comptable et la tentation peut être grande lorsque l’on est en phase de constitution d’une clientèle. Néanmoins, si le preneur a le pouvoir de dire oui (au client), il a surtout le devoir de lui dire non, afin de respecter son confrère, et plus globalement le corps professionnel. La loyauté envers son confrère prime sur le lucre.
Face à une telle demande, le preneur doit en aviser le donneur d’ordre afin d’attirer son attention sur la fragilité de la relation contractuelle. Et il aura peut-être la bonne surprise que celui-ci, estimant qu’il allait perdre un client, en accepte la reprise.
DP : Faut-il informer son Conseil régional de l’Ordre quand on signe un contrat par lequel on confie des travaux à un confrère ?
JMJ : Aucun texte n’oblige à en informer son conseil régional. Il est toutefois recommandé de signaler la signature d’un contrat de collaboration libérale, notamment si le collaborateur libéral est désigné responsable déontologique d’un bureau secondaire. C’est aussi dans le but d’organiser son contrôle de qualité en même temps que celui du cabinet qui recourt à ses services.
DP : En cas de désaccord entre les parties, doit-on obligatoirement saisir son Conseil régional avant toute autre action judiciaire ?
JMJ : Oui, pour au moins deux raisons. La première, c’est qu’il s’agit d’un principe posé par l’article 161 du décret précité qui donne pouvoir au Conseil régional de régler, ou au minimum de tenter de régler, les différends entre experts-comptables. La deuxième, c’est que les tribunaux peuvent refuser de statuer tant que le litige n’a pas été soumis à la conciliation ou à l’arbitrage de l’instance ordinale.
DP : Le contrat de collaboration libérale n’est-il pas trop déséquilibré en défaveur du collaborateur libéral ?
JMJ : Lorsque je sévissais dans ces deux nobles institutions que sont l’ANECS et le CJEC, j’étais fermement opposé à la collaboration libérale. D’ailleurs, je n’avais pas manqué d’exposer mon hostilité lorsqu’ont débuté les premières discussions interministérielles qui ont abouti plusieurs années après à son encadrement législatif[3]. A l’époque, aucune disposition législative ou réglementaire n’encadrait la collaboration libérale et nous pouvions juste nous référer à la pratique, peu envieuse, des avocats. Les dispositifs appliqués par d’autres professions visaient principalement le remplacement et n’étaient pas adaptés à l’exercice de notre profession.
Mon opinion a aujourd’hui évolué, en dépit des excès toujours constatés chez les avocats. Bien que le dispositif législatif se limite à un seul article de loi, il apporte des garanties aux jeunes professionnels sur au moins deux plans : la maternité et la paternité d’une part, la constitution et le traitement d’une clientèle personnelle d’autre part. Certes l’article 12 de notre ordonnance autorise aussi les experts-comptables salariés à exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions et mandats qui leurs sont confiés par des clients, mais dans les conditions prévues par les conventions qui les lient à leurs employeurs. En général, cette porte entrouverte par notre réglementation est aussi vite refermée par les employeurs, les contrats de travail prévoyant généralement une exclusivité. Dans le cadre de la collaboration libérale, il est interdit d’empêcher le collaborateur libéral de se constituer et de servir sa propre clientèle, sous peine d’aboutir à la requalification de la coopération en salariat. En outre, le cabinet preneur doit mettre à la disposition de son collaborateur les moyens matériels de servir sa propre clientèle (informatique, documentation…), un avantage indéniable lorsqu’on se lance. Cette clientèle, aussi infime soit-elle, peut également être valorisée si les partenaires décident de s’associer.
En revanche, le collaborateur libéral est obligatoirement une personne physique. S’il contracte par l’intermédiaire d’une société, il ne peut prétendre à ce statut. La collaboration libérale est également interdite pour les missions de commissariat aux comptes. Seules pourraient être déléguées à un collaborateur libéral des missions d’assistance dans les missions de commissariat aux comptes, et à condition que ces interventions demeurent marginales par rapport aux autres activités relevant du contrat de collaboration.
DP : Existe-t-il des exemples de contrat qui préserveraient les jeunes experts-comptables ?
Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables propose deux exemples : le contrat de collaboration libérale et le contrat de prestations de services. Ils ne sont pas plus protecteurs des intérêts d’une partie que d’une autre. Le Conseil supérieur a recherché l’équilibre. Ces exemples sont accessibles sur son site internet[4].
[1] Jean-Marc Jaumouillé est élu du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables, au sein duquel il assure notamment la présidence de la commission du Tableau.
[2] Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
[3] La collaboration libérale est régie par le seul article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME.
[4] Espace privé du site internet de l’Ordre des experts-comptables : Exercice professionnel / Réglementation et déontologie / Réglementation et déontologie : l’actualité.